Nouveau / Revalorisation de la corniche d’Agadir : déploiement de l’architecture d’éclairage télégéré
Dans le cadre du renforcement des compétences de ses adhérents, axe stratégique que le Réseau du développement du tourisme Rural Souss Massa, priorise au niveau de sa vision, une convention de partenariat a été conclue avec le RDTR grâce à l’appui du Conseil Régional Souss Massa et l’accompagnement de l’Agence Nationale de Promotion de l'emploi et des Compétences (ANAPEC).
A cet effet, le RDTR ne ménagera aucun effort pour concrétiser et appuyer les orientations royales affirmées, notamment durant le discours du Trône. Notre région connaît des mutations territoriales profondes et rapides et nous devons être exemplaires pour l’accompagner en s’investissant au niveau du renforcement des compétences de l’élément humain pour booster la qualité des services du produit touristique rural.
La vocation du RDTR à travers ce partenariat est d’abord animer notre communauté et accompagner notre réseau de professionnels en monde rural dans son développement et son professionnalisme ; puis favoriser l’insertion des jeunes non diplômés dans les métiers du tourisme rural, à travers la mise en place de cette formation qualifiante pour former des Agents Polyvalent des Gites.
« Notre objectif à terme : que nos formations soient certifiantes et reconnues comme un socle de formation sur le secteur du tourisme rural. Nous travaillons avec les organismes de qualification dans ce sens, avec une ouverture vers les jeunes non diplômés hors adhérents du réseau, chose qui confirme notre noble mission qui est le développement rural à travers la mise à disposition de nos professionnels, une main d’œuvre qualifiée et qui répond parfaitement aux exigences du marché du travail » explique SABRI Abdelhakim, Président du RDTR.
Le plan de formation validé à ce sujet vise un volume horaire de 120 heures en mode présentiel et se focalise sur 2 volets essentiels, notamment la valorisation des métiers via les techniques d’accueil et de réception, techniques de base en cuisine, le service au restaurant, le service des étages. Mais aussi un module transversal visant le développement des compétences en communication interpersonnelles et digitale permettant aux candidats de savoir gérer la réservation avec les OTAs, comment communiquer sur les réseaux sociaux et comment mieux gérer les avis clients.
En complément des modules théoriques, des travaux pratiques renforcerons certes les acquis communiqués par les formateurs, mais aussi afin de faciliter leur intégration en milieu de travail, des stages seront organisés et encadrés par le RDTR afin de valider leurs parcours de formation certifiante.
« Nous remercions vivement à cette occasion Monsieur le Wali de la région Souss Massa et
le Conseil Régional Souss Massa pour leur assistance et appui, ainsi que l’Anapec pour son accompagnement ».
Source : Communiqué de Presse
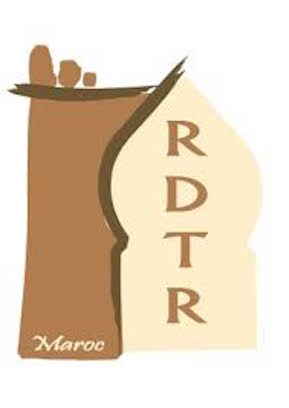
Pour les fêtes de fin d’année, la compagnie aérienne Transavia France prévoit de relier les aéroports de Nantes et de Fès. Elle envisage aussi de renforcer son programme de vols au départ de l’aéroport de Lyon vers Agadir et Marrakech.
La low cost lancera le mois prochain, depuis sa base à Nantes-Atlantique, une nouvelle liaison vers l’aéroport de Fès-Saiss. Des vols aller simple sont prévus sur cette ligne les 16, 21, et 28 décembre 2021 et le 04 janvier 2022, à partir de 49 euros TTC, fait savoir Air Journal.
Transavia prévoit aussi de prolonger sa route entre Lyon et Oujda-Angads au cours de cette période de fin d’année, avec des vols aller simple à partir de 44 euros, les 18, 22, 25 et 29 décembre 2021 et le 1ᵉʳ janvier 2022. De même, la compagnie aérienne veut renforcer son programme de vols au départ de l’aéroport lyonnais vers Agadir, Marrakech, Beyrouth, Djerba, Monastir, Porto, Tel Aviv et Tunis.
Par ailleurs, la compagnie à bas coût propose aussi des fréquences supplémentaires de vols en aller simple à partir de 29 € TTC, de Nantes vers Casablanca, Marrakech, Djerba, Rome, Lisbonne, Porto, et Tunis, les 18, 25 et 30 décembre 2021.
« Nous sommes très heureux d’offrir de nouvelles possibilités de voyages à notre clientèle lyonnaise et nantaise. Nos passagers peuvent désormais planifier leurs vacances et retrouver famille et amis tout en bénéficiant d’une offre low-cost de qualité au départ de leur aéroport », a indiqué dans un communiqué, Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France.
Source: bladi.net
Casablanca, le 09 novembre 2021 – Royal Air Maroc lancera, à compter du 12 décembre
2021, une nouvelle route aérienne directe reliant Casablanca à Tel Aviv. Trois
fréquences seront opérées avec un vol d’une durée de moins de cinq heures et demie.
Le nombre de fréquences passera en peu de temps à cinq vols par semaineRoyal Air Maroc lancera, à compter du 12 décembre 2021
d
Les vols au départ de Tel Aviv seront, quant à eux, programmés tous les lundis, mercredis et vendredis avec un décollage à 07h15 (heure locale) et une arrivée à Casablanca à 12h10 (heure du Maroc).
Les billets sont proposés à des prix de lancement à partir de 3400 Dirhams (TTC) allerretour en classe économique. Ils sont désormais disponibles à la vente sur le site Internet de la Compagnie Nationale (www.royalairmaroc.com) et à travers ses centres d’appel et ses agences commerciales ainsi qu’à travers le réseau des agences de voyages.
Cette nouvelle liaison répond aux attentes de la communauté marocaine établie en Israël qui entretient des liens forts avec son pays d’origine. Elle vise aussi à permettre aux touristes, ainsi qu’aux femmes et hommes d’affaires, de se rendre au Maroc ou en Israël.
Source : Communiqué de presse
 Accueil
Accueil






























